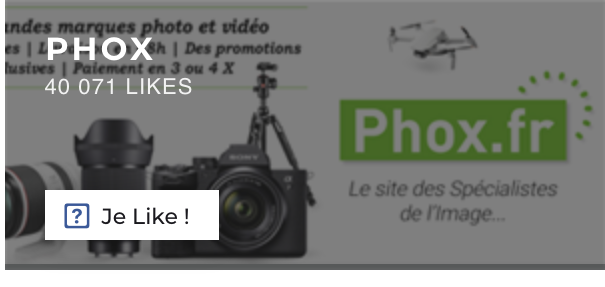Lorsqu’il quitte le champ des caméras, Nikos Aliagas s’adonne corps (cœur) et âme à la photographie, toujours à l’affût de belles lumières et de rencontres spontanées.
Sa prochaine exposition Parisiennes, affichée sur les grilles de l’Hôtel de Ville de Paris, il rend hommage aux femmes de la capitale, en noir et blanc bien sûr.

Portrait Nikos Aliagas

Kids Tourlida Beach

Catharsis Athènes (Carnaval) 2019

Raica Oliveira, une brésilienne à Paris

KOSTAS, poissonnier messologi

Main feuilles de thé – Sri Lanka
« Derrière l’objectif, je retrouve une forme de liberté »
« Physiquement, quand on va chercher une photo, il y a toute une action qui se fait avec le corps, avec la projection de la pensée, et à la fin, avec le cœur »
À quand remonte votre passion pour la photographie ?
Je me suis mis très tôt à la photographie. Quand j’étais gamin, mon père m’a offert un Kodak Instamatic. Cela me permettait de photographier des pieds, tout sujet qui se trouvait à mon échelle, avec mes yeux d’enfant. J’étais un rêveur. Je parlais toujours en photo.
Mes souvenirs décrivaient une image. Il m’arrivait de dire à mes parents : « Je me souviens on est passé à tel endroit en voiture, il y avait tel ciel et telle personne assise devant une statue ce jour-là. Une sorte d’hypermnésie d’images, qui me faisait rembobiner, le soir, le film de mes photos imaginaires.
Cette mémoire photographique m’a poussé, lorsque j’étais jeune journaliste à la fin des années 80, à commencer à cadrer, en tant que caméraman, pour Euronews. Par la force des choses, quand je suis arrivé à TF1, j’ai fait moins de photo, car j’ai dû apprendre un nouveau métier.
Puis, petit à petit, j’ai ressenti un manque. Même avec un téléphone, j’avais besoin de cadrer, de créer un monde dans un cadre X ou Y. Il y a une quinzaine d’années, je me suis équipé avec du matériel un peu plus sérieux en numérique. J’ai recommencé à photographier régulièrement.
Vous avez déclaré que la photographie agissait comme un anti-stress pour vous. En quoi vous permet-elle de déconnecter ?
C’est vrai ! Le fait de passer derrière l’objectif est un acte qui prend une autre signification pour moi qui suis régulièrement devant. En tant que sujet filmé ou photographié, on se retrouve à la merci de la personne qui est derrière.
En inversant les rôles, je retrouve une forme de liberté. Cela me permet de raconter des histoires. Lorsque je me trouve face aux objectifs, je fais mon travail. En tant que photographe, je n’ai pas de tâches professionnelles. J’explore un autre univers. Un autre espace-temps.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet Parisiennes ?
Je vois Paris comme une scène de théâtre. Je le ressentais déjà, étant gamin, en me baladant les soirs avec mon père, j’avais l’impression d’évoluer dans un décor en carton-pâte. Sauf que les femmes ne sont pas des figurantes. Elles sont l’âme de la ville.
Toutes celles qui ne demandent jamais rien, mais qui sont toujours là.
Qu’elles soient cavalière à la garde républicaine, coiffeuse, infirmière, qu’il s’agisse d’une vielle dame qui attend le bus, ou de deux amies qui picolent sur un banc hilare et qui me demandent de ne pas les prendre en photo : « Nos maris pensent qu’on fait des courses ! ». Ce sont ces femmes, que je voulais photographier.
Quel part de mise en scène y a-t-il dans votre travail ?
Je fais très peu de mise en scène. Ou alors, si ça arrive, c’est assumé et ça en devient drôle. La plupart des photos du projet Parisiennes ont été prises dans la rue, à l’insu des sujets. Dans la foulée, j’allais les voir pour les en informer.
Ou bien je demande à quelqu’un de reproduire une scène, une action qui a retenu mon attention, comme le simple fait de marcher.
J’ai un bel exemple en mémoire, une femme de 88 ans, qui vit au premier étage, au-dessus de son salon de coiffure, dans le Xe arrondissement.
Cela fait plus de trente ans que je veux la photographier. Je n’osais pas y aller. J’ai toujours été intimidé par sa beauté. Lorsque j’ai franchi le pas, elle m’a répondu qu’elle m’attendait depuis longtemps. Elle adorait mon père.
Elle est assise dans son canapé, sans maquillage, dans un décor de bric et de broc, des appareils pour lisser les cheveux sortis des années 60. Un autre monde.
Il se produit autre chose, presque de l’ordre de la vibration. Cela va plus loin que la photographie. On est comme aspiré par la force du moment vécu. Je suis allé dans un hôpital, dans le cadre de l’exposition Parisiennes.
Je me suis retrouvé dans un service où j’avais été moi-même hospitalisé. Je n’avais pas établi le lien, lors de la prise de rendez-vous pour le shooting.
La première personne qui m’a accueilli, m’avait à l’époque pris en charge, en tant que patient. Elle revenait à moi, dans la peau d’un sujet. Cela ne pouvait pas être qu’une photo. C’était la boucle de quelque chose. La gratitude que je lui vouais, dans mon cœur, dans mes yeux, devait passer par le clic photographique.
La notion de temps semble primordiale à vos yeux, comme en atteste votre beau-livre, L’épreuve du temps. Quel est votre rapport au temps, en tant que photographe ?
Je n’ai pas de pression du résultat. Je ne fais que suivre mes émotions. Je peux passer des heures dans une ruelle, en Grèce ou en Espagne, à attendre quelque chose. Je pense qu’il faut laisser reposer une image.
En revoyant certaines images, quelques années plus tard, j’ai réalisé je n’avais pas la grille de lecture ou la maturité nécessaires pour en saisir les nuances, au moment où j’avais déclenché. Dans ma tête, je reste un amateur. Je n’ai pas toutes les clefs. Je me fie à mes émotions, à mon cœur.
Physiquement, quand on va chercher une photo, il y a toute une action qui se fait avec le corps, avec la projection de la pensée, et à la fin, avec le cœur. Les photos que je retrouve avec plaisir émanent d’un coup de cœur.
À moi de saisir la nuance, la sincérité, sur le moment, même dans l’urgence – il y a une urgence, quand on photographie, la respiration n’est pas la même – en restant le plus zen possible. C’est un paradoxe, quand même.
Vous prenez aussi la plume, pour raconter des histoires autour des photos, notamment sur votre compte Instagram. Quelle importance accordez-vous aux mots ?
La plupart du temps, les photos n’ont pas besoin de mots. Mais parfois, je ressens le besoin de raconter l’autre chemin, ce que l’on ne voit pas dans le cadre. Je n’explique pas la photo. Je donne des éléments pour la mettre en perspective.
J’ai besoin d’écrire quelque chose qui soit en équilibre entre l’image et le texte. De contextualiser sans paraphraser. La ligne n’est pas évidente. J’aime bien savoir les histoires autour des photos. J’adore lire ou écouter Sebastião Salgado. Il me fascine. Son verbe est complémentaire de ses images. Tout cela, je me l’imagine, en regardant ses images.
Vous photographiez uniquement en noir et blanc. Quels photographes vous ont le plus influencé, en dehors de Salgado ?
Certainement les photographes humanistes. Les images de Sabine Weiss touchent à quelque chose de l’ordre de l’archétype humain.
C’est une femme délicieuse, que j’ai eu la chance de rencontrer et photographier plusieurs fois. Elle garde une telle distance avec son œuvre.
Quand elle raconte les détails, c’est comme si ce n’était pas elle qui avait pris la photo ! Elle est exceptionnelle. Il y a bien sûr des photos d’André Kertész qui sont des joyaux d’architecture et de cadre.
Celles d’Henri Cartier-Bresson, naturellement. Willy Ronis aussi. Josef Koudelka, le patron dans de multiples domaines à mes yeux. Il est dur. Il est sans compromissions. J’aime bien JR, pas seulement un grand photographe, mais un homme d’engagement, d’idées et de concepts artistiques. Il y en a tant d’autres…
Les mains constituent un sujet récurrent dans votre travail. Pourquoi y attachez-vous une telle importance ?
Je ne retiens pas forcément un prénom, mais je n’oublie jamais un visage, ou une main. C’est dur les mains. C’est intime. Sans concessions. Les mains disent ce que le masque social dissimule. Les ancêtres, la généalogie, la morphologie, l’hygiène, tes secrets, tes névroses, qui tu es.
Les mains sont sans doute la seule partie du corps qu’on ne peut pas changer. Mon père était tailleur. Nous n’avions pas de sous et vivions dans une petite pièce. Un de mes loisirs consistait à observer ses mains sur les tissus. Je pense que mon attirance pour les mains vient de là. C’est sûr.
Vous avez toujours votre matériel à portée de main ? Quels sont vos outils de prédilection ?
Comme tout photographe qui se respecte ! J’alterne entre les EOS 5DSR et R5. Ce boîtier sans miroir est très rapide, les fichiers sont presque aussi volumineux que ceux du reflex de 50 Mpxl.
Je trouve qu’il y a un velouté impressionnant sur les images. Je travaille quasiment tout le temps en focales fixes.
Mais avec l’EOS R5, je ne parviens pas à démonter le zoom RF 28-70 mm f/2L USM. Il est monstrueux, tant sur le plan des résultats que du gabarit.
Il me donne une certaine assise, au moment de la prise de vue. J’ai réalisé plus des deux tiers de mes photos avec, dernièrement.
J’utilise aussi le RF 85 mm f/1,2L USM, une focale que j’affectionne. Il m’arrive parfois, selon la lumière, de capturer certains instantanés à l’iPhone.
Pour découvrir notre sélection d’équipements de photographie, d’optiques, de matériel vidéo, de son, de drones, de trépieds, de bagagerie, de solutions de stockage, d’énergie, de flashs, de produits de téléphonie multimédia, ainsi que des articles d’occasion, rendez-vous sur la page de Phox.fr